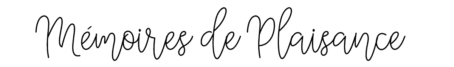Première assemblée
Premiers pas vers une assemblée communale 1787 Contexte historique En 1787, la royauté est sur son déclin. La Noblesse et le Haut-Clergé défendent à tout prix leurs privilèges exorbitants. Le Tiers-État, composé d’une part de l’immense majorité du peuple exploité, qui prend conscience de ses malheurs, et d’autre part, d’une bourgeoisie à son aise, certes, mais qui ne bénéficie pas des privilèges de la noblesse, ni du Haut-Clergé. En gros, trois couches de population : les grands exploiteurs, les couches moyennes et le peuple des travailleurs, paysans, ouvriers, artisans, pressurés de toutes les manières. 12 août 1787 Jacques Delion de Surade ÉLECTION DU CONSEIL DE LA COMMUNE En ce 12 août 1787, la paroisse de Notre-Dame sur Gartempe, compte 66 feux. Le syndic a réuni ce jour-là, à 4h de relevée, à l’issue des vêpres, l’assemblée municipale composée uniquement des habitants payant au moins 10 livres d’imposition pour élire le conseil de la commune. Seront élus : le syndic, Félix Vauzelle, ainsi que trois membres, tous selon la loi, ayant au moins 25 ans, habitant depuis plus d’un an la commune et payant au moins 30 livres d’impôt. Le sieur Delion de Surade fait partie de droit du conseil en sa qualité de prieur et curé1. 12 février 1788 24 février 1788 Félix Vauzelle, démissionne le 12 février 1788 (on n’en connaît pas la raison). C’est Florent Audoux, sergetier et cabaretier qui sera élu syndic et qui, déjà membre du conseil, sera remplacé dans sa charge d’officier municipal par Louis Gourdonneau, tailleur d’habits. Le 24 février, le conseil procédera à la nomination d’un greffier : Mario Vauzelle, tisserand, demeurant au faubourg de cette ville2. 17 août 1788 Des assemblées hebdomadaires Le 17 août, le conseil décide que les assemblées seront tenues chacun des dimanches de l’année sans convocation. Les réunions se tiendront en effet tous les dimanches, même s’il n’y a pas d’objet de délibération, mention en est faite au registre les 7, 14, 21 septembre. Recensement des non-catholiques Le 17 août, le conseil répond aux lettres de l’autorité supérieure. Il déclare qu’il n’y a aucun non-catholique dans la paroisse. Ce recensement des non-catholiques de Plaisance correspondait à la publication d’un Édit Royal du 29 juillet 1788 accordant à ceux-ci les droits civils. Ils pouvaient désormais faire enregistrer légalement leurs mariages, naissances et décès. Ils obtenaient la faculté d’exercer tous les métiers sauf les charges (magistrat, gouverneur, intendant, notaire, etc.). La liberté du culte leur était cependant encore interdite. 24 août 1788 Impositions Le conseil avait demandé qu’aucune estimation ne soit faite, la commune ayant été déjà vérifiée. Autrement dit, on demandait que l’impôt ne soit pas augmenté. Une nouvelle lettre est envoyée le 24 août, à l’assemblée intermédiaire pour demander de diminuer les tailles à Plaisance, se montant à 490 livres, car la commune avait été augmentée les années précédentes à cause des communes voisines qui avaient été grélées. 28 septembre 1788 Le 28 septembre 1788, l’assemblée municipale des propriétaires payant 10 livres d’impôt est convoquée, après la première messe paroissiale, pour s’assembler dans la grande chambre du Sieur Laurendeau, située sur la place de l’église. Il s’agit de nommer les collecteurs d’impôt pour les années 1789 et 1790. Sont nommés, pour 1789 : Desvignes et Jaladeau. pour 1790 : Jean Tabuteau, Fermier de chez-Challais, Jean Chartier, fermier de la Merlatrie, François Hebras, métayer au cimetière. 1. Prieur, curé : Religieux, desservant, une cure dépendant d’un monastère, probablement celui des moines Augustin de Montmorillon. 2. Syndic : Mario Vauzelle n’était éligible que parce qu’il était imposé pour 30 livres. Les électeurs eux-mêmes payaient 10 livres d’imposition au moins. Le syndic était donc, en fait, le représentant des propriétaires. Les autres habitants ne participaient en aucune manière à la vie communale. Même parmi les notables, les illettrés étaient nombreux, aussi votait-on par oui ou par non à l’aide de grains de millet blancs ou noirs servant de bulletin de vote. Le rôle de Vauzel était important : C’était lui qui préparait la levée de l’impôt et le recrutement de la milice. Il s’occupait de la réparation des chemins, du logement des troupes de passage. Il était chargé d’informer l’intendant de Poitiers, représentant du pouvoir royal, de tous les évènements qui intéressaient la tranquillité publique (incendies, épidémies…). Il pouvait être frappé, par l’autorité supérieure, de lourdes amendes s’il remplissait mal sa tâche (30 livres en cas de mauvaise destruction des chenilles, 500 livres s’il avait négligé d’établir, en présence du juge et du curé, la liste des jeunes gens qui devaient tirer au sort pour le service militaire). Il pouvait être révoqué par l’intendant. Sa situation était délicate. Il se trouvait pris entre l’enclume et le marteau, c’est à dire entre les exxigences des habitants qui l’avaient élu et celles des seigneurs ou de leurs représentants. Son seul bénéfice, à part l’honorabilité de sa situation, était d’être exempté de la taille et de percevoir, éventuellement, une petite gratification. Le syndic appuyait son autorité sur l’assemblée communale, celle qui l’avait élu, et qu’il réunissait souvent. Mais ces assemblées communales où l’on discutait beaucoup inquiétaient le pouvoir central et, en 1787, elles furent remplacées par des Conseils des Notables. Les seigneurs, qui ne nommaient aucun représentant dans la ville de Plaisance, ne semblent pas avoir profité de leur droit de présence au Conseil des Notables. Le cahier de doléances de Plaisance regrettera d’ailleurs l’absence de ces officiers publics seigneuriaux (juge, greffier, procureur fiscal, sergents royaux). Le 5 octobre 1788, le conseil demande à l’assemblée provinciale qu’il soit alloué à la commune la somme de 3 livres pour frais de bureau, tant pour le présent registre que pour autre papier et autres frais de bureau et la somme de 21 livres pour gratification au syndic et greffier. 24 mai 1789 Vacher de la Pouge est élu greffier, le 24 mai 1789, en remplacement de Mario Vauzelle. Les finances royales Aucune préoccupation concernant la situation de la France ne semble apparaître dans ces paisibles petites affaires administratives de routine de cette paroisse. Déjà, pourtant, en