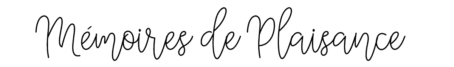Le Poitou au XIVe siècle Le Poitou au XIVᵉ siècle subit des alternances de domination au cours de la guerre de Cent Ans. De 1360 à 1372, le Poitou est sous le contrôle de l’Angleterre et intégré à la Principauté d’Aquitaine. C’est alors que se met en place une administration spécifique avec un mode de gestion adapté à ces nouvelles régions. Après une reconquête ardue menée jusqu’en 1375 par Du Guesclin, le Poitou et les pays de l’Ouest passent sous le contrôle de la France et font partie de l’apanage du Duc Jean de Berry. Pendant les périodes où ils sont officiellement absents de la région : 1320-1356 et 1375-1415, les Anglais maintiennent une pression permanente sur la région, au moyen de raids, de chevauchées destructrices et de tentatives de débarquement avortées ou réussies. Il s’agit d’une nouvelle région où la domination anglaise s’exerce sous des formes très spécifiques. On peut ainsi avoir une vue d’ensemble des régions conquises et dominées par l’Angleterre pendant la Guerre de Cent Ans. On peut aussi y constater une nouvelle forme de « recovery » mise en place après chaque moment de tension et de conquête, soit par les Français, soit par les Anglais et ainsi étudier cette réalité politique de manière plus globale. Enfin, on peut aussi étudier l’intégration de cette région à un ensemble plus vaste constitué par la principauté d’Aquitaine. Sources : Elodie Giard, Le Poitou et les Pays de l’Ouest entre la France et l’Angleterre de 1337 à 1415. Journal de M. Demaillasson Thibaut de Lantigny, chevalier, seigneur de l’Age de Plaisance, épousa (vers 1320) Almodis Rabaud, dame de Chaume, veuve d’Ithier Brûlon, et en eut un fils unique, Jean, auquel sa mère donna son hébergement de Chaume eu le mariant à Jeanne Scschaud, fille de Guiot, écuyer. En récompense, Jean de Lantigny assure à sa mère quatre livres de rente. II ne laissa qu’une fille, Philippe de Lantiguy, dame de l’Age de Plaisance, dont la succession alla par moitié à Huguet Brùlon et à Catherine, sa sœur (Baron d’Huart, Hist. de Persac, Antiq. Ouest, 2′ série, t. X, p. 183 et 391.) 13 février 1302 Cession faite à la Maison-Dieu de Montmorillon par Jean, comte d’Eu et de Guines, seigneur de Civray, de tout ce qui lui appartenait dans les villes et paroisses de Thenet, du Dorat, de Lussac, de Saint-Savin, tle la Trimouille, de Plaisance, de Morterolles, et dans la châtellenie de Montmorillon. ID. Fonteneau, t. XXIV, p. 473, d’après Robert du Dorat.) A tous cculx qui verront et orront ces presentes lettres, Jehan, comte d’En et deGuyncs salut en Nostre-Seigneur. Sachent tousavons ès ventes et en autre chose qui appartiennent à la boete commune entre nous et Pierre de Poquières, valet, et toutes les autres choses que nous avons et avoir pouvons pour quelque cause ou raison en quelconque manière en la ville et chastellenie de Lussac, de Saint-Savin et de la Tremoille et en la ville et paroisse de Plaisance, et en toutes les appartenances des villes et des chastellenies dessus dites, soit rentes, coustumes ou debvoirs, bled, vin, gelines, terres, prez, vignes, bois, landes, pasturages, eaux, rivieres, hommes, maisons, tenues, courtillage, jurisdiction, obeissances, servitudes, coustumes, aydes et autres choses quelsconque elles soient, et la grand justice et petite, haute et basse, en toutes les choses dessus dites et de chascune d’icelles, et toutes les issues, proffits et esmoluments, qui doresnavant y seront des choses dessus dites et de chascunes d’icelles pour quelconque cause que ce soit, et tout le droit de propriété, de possession, action, demendes que nous avons et avoir pouvons ès choses dessus dites et en chascunc d’icelles, avoir et tenir des dits religieux et de leurs successeurs et de ceulx qui auront cause d’eulx et de nos hoirs et successeurs tout, tant que nous avons de propriété, de possession, de droit ès choses dessus dites et un chascune d’icelles, excepté les quatre cas de haulte justice cy emprès divisés, c’est assavoir rapt, encis, meurtre et trahison, quand en appartient ès cas de la haulte justice, lesquels quatre cas nous reservons, ô toute mere impere, qui luy appartient ou peut appartenir en son ressort en toutes les choses dessus dites, desquels quatre cas la cognoissance est réservée à nous et à nos hoirs et à nos successeurs qui seront seigneurs de Civray, quand les cas en adviendront, et feront la justice et l’execution des malfaiteurs ès dits quatre cas, ès lieux que nous leur avons baillé, non pas tant près de leur maison, qu’en soit en vitupère d’eulx ne de leur herbergement, et ils nous ont promis bailler place suffisante à ce faire, et tout l’esmollument et proffit qui en adviendra sera commun par moitié entre nous et nos hoirs d’une partie, et les dits religieux d’autre partie, laquelle l’autre partie les dits religieux auront par nostre main et toute autre congnoissance et justice grande et petite, haute et basse, excepté les dits quatre cas et ce que nous avons retenu, si comme dessus est dit et appartiendra doresnavant et appartient aux dits religieux et à leurs successeurs.Et s’il advenoit qu’aulcuns malfaicteurs ès dits quatre cas feussent prins par les gens aux dits religieux ou par autres ou par les notres ès lieux et en la justice dessus dite, les dits religieux serontles proclamations auront esté duemant faittes sur les lieux. Et quand au dit Lenoir, quy seroit arrivé au dit Montmorillon le jour 29 aoust, auroit le dimanche ensuivant fait réitirer les dittes affiches aux prunes des messes dites et cellébrées ès parroisses de Saint-Martial, Concize du dit Montmorillon, ensemble es parroisses de Joue, Notre-Dame de Plaisance, Saint-Remi, Lussac-le- Chasteau et Latus proximité du dit lien, affin que s’il y avoit aucun quy voullut enchérir qu’il est à se retirer par devers luy pour recevoir leurs enchères le dit dernier jour. Comme du tout il nous est aparu par le certifficat des curez des dittes parroisses mis au pied de ses affiches suivant lesquelles ce seroient présentés par deversluy ce jour