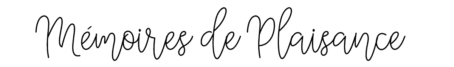Croix Hosannière
Un peu d’histoire… 1894 Croix Hosannière – Photographie 1952 Travaux de fouilles archéologiques du R.P. de la Croix Archéologue dans une seconde vie, le Père Camille de la Croix fit des découvertes au vieux cimetière de Plaisance en 1894. Fort de l’expérience qu’il a acquise sur ses chantiers de fouilles, il se voit confier en août 1884 une mission par le Conseil général de la Vienne : dresser la « carte archéologique, gauloise, gallo-romaine et mérovingienne de la Vienne » pour l’Atlas cantonal du département. De 1884 à 1896 pour le compte de cette publication du Conseil général, puis de sa propre initiative ensuite, il sillonne le département de la Vienne pour en exhumer les trésors archéologiques : Antigny, Civaux, Charroux, Jaulnay-Clan, Jazeneuil, Nouaillé-Maupertuis, Plaisance, le Vieux-Poitiers près de Châtellerault, Vouneuil-sur-Vienne, etc. En juillet 1894, le révérend père Camille de la Croix, membre de la Société des Antiquaires de l’Ouest, entreprend des fouilles archéologiques dans le cimetière de Plaisance autour de la dite Croix Hosannière. Il dresse un état précis de l’édifice qui comprend un pourrissoire situé au pied du monument. Il semble que la construction a evolué dans le temps entre Croix Hosanniere et Lanterne des morts. Suite à un affaissement du terrain, elle fut démontée en …. et stockée en lieu sûr en attendant une restauration dans les règles. R.P. Camille de la Croix (1831-1911) Croquis de fouilles R.P. de la Croix Croquis de fouilles R.P. de la Croix Croquis de fouilles R.P. de la Croix Le révérend père Camille de la Croix Communes de fouilles dans la Vienne Communes de fouilles dans la Vienne Diplome de la Société des Antiquaires de l’Ouest en 1877 Légion d’honneur délivrée en 1896 Camille-Adolphe-Ferdinand-Marie de La Croix naît en 1831 à Mont-Saint-Auber, près de Tournai (Belgique), le 21 juillet, et non le 14 juillet comme on peut le lire dans plusieurs articles et publications, ainsi que dans son dossier de Légion d’honneur et son acte de décès. Issu de l’aristocratie belge, il fait ses études au collège jésuite de Brugelette, près d’Ath (Belgique), puis à celui de Vannes de 1850 à 1853. Il choisit alors d’entrer en religion, comme son frère Adrien et ses trois sœurs. Après son noviciat à Issenheim (Haut-Rhin), il poursuit ses études de théologie jusqu’à être ordonné prêtre à Paris, le 24 septembre 1864. Dans le même temps, il est professeur de musique au collège jésuite de Metz en 1857, puis au collège jésuite Saint-Joseph de Poitiers à partir de 1864, bien que l’arrêté ministériel l’autorisant « à exercer en France des fonctions d’enseignement dans les établissements libres d’instruction secondaire » ne soit pris que le 10 février 1869. Dans le cadre de la confection d’une chape et d’une étole que le diocèse de Poitiers compte offrir au pape Pie IX, le R. P. de La Croix entreprend en 1876 des recherches documentaires sur les premières grandes figures chrétiennes en Poitou. De la documentation historique, il passe à la pratique archéologique en 1877, en fouillant l’église Saint-Hilaire-de-la-Celle, à la recherche de vestiges de saint Hilaire, premier évêque de Poitiers. Débute alors la seconde vie du R. P. de La Croix, celle de l’archéologue. Nommé membre titulaire résident de la Société des antiquaires de l’Ouest, le 15 novembre 1877 (Bulletin de la Société des antiquaires de l’Ouest, 2e série, t. I, 4e trim. 1877, p. 161), le R. P. de La Croix n’a de cesse de fouiller et de valoriser le fruit de ses recherches par des communications et des publications scientifiques. Ses premiers chantiers de fouilles ont lieu à Poitiers. Après avoir révélé les vestiges des thermes romains de Poitiers dans le polygone formé par les actuelles rues Jean Bouchet (ancienne rue des Curés pour les anciens noms de rues de Poitiers, voir les plans du cadastre napoléonien aux Archives départementales de la Vienne datés de 1837-1838 et disponibles sur leur site internet, ainsi que l’ouvrage BROTHIER DE ROLLIERE Raoul, Histoire des rues et guide du voyageur, Poitiers : Lévrier, 1907, réimp. Poitiers : Brissaud, 1988, p. 366), de la Bretonnerie et Saint-Germain (ancienne rue des Buissons), il se consacre, de 1878 à 1880, aux fouilles de l’Hypogée-martyrium des Dunes, crypte mérovingienne également appelée Hypogée de Mellebaude. Découverte majeure pour l’histoire paléochrétienne du Poitou, l’Hypogée des Dunes fait la renommée du R. P. de La Croix et l’introduit dans le cercle des savants et érudits nationaux, tels Jules Quicherat avec qui il entretient une correspondance jusqu’au décès de ce dernier, en 1882. La seconde découverte archéologique majeure du R. P. de La Croix est le site gallo-romain de Sanxay, dans la Vienne, dont il dirige les recherches de 1880 à 1883. Fort de l’expérience qu’il a acquise sur ses chantiers de fouilles, il se voit confier en août 1884 une mission par le Conseil général de la Vienne : dresser la « carte archéologique, gauloise, gallo-romaine et mérovingienne de la Vienne » pour l’Atlas cantonal du département. De 1884 à 1896 pour le compte de cette publication du Conseil général, puis de sa propre initiative ensuite, il sillonne le département de la Vienne pour en exhumer les trésors archéologiques : Antigny, Civaux, Charroux, Jaulnay-Clan, Jazeneuil, Nouaillé-Maupertuis, Plaisance, le Vieux-Poitiers près de Châtellerault, Vouneuil-sur-Vienne, etc. Jouissant d’une bonne réputation, le R. P. de La Croix est amené à prendre part à des chantiers de fouilles archéologiques en dehors du département de la Vienne. Dans les Deux-Sèvres, il s’intéresse notamment à la chapelle et au château de Vernay, et dirige les travaux archéologiques des sites de Louin et de Rom. En 1895, il prend de court la Société archéologique de Touraine en s’appropriant la direction des fouilles à Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire, France). L’année suivante, il part pour l’abbaye de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) ; les interprétations qu’il donne de ses découvertes sont à l’origine d’une polémique assez violente, entre 1903 et 1908, avec la Société archéologique de Nantes, au premier rang de laquelle se trouve Léon Maître, directeur des Archives départementales de Loire-Atlantique. En 1896-1897, il dirige les fouilles menées à