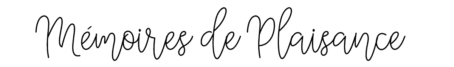Épisode 11
Affaires diverses à Plaisance de 1790-1795 Relevé des affaires diverses de 1790 à 1795 à Plaisance, publiées dans l’ouvrage de Louis Germaneau Printemps 1794 Faits divers à Plaisance 13 mars 1794 23 ventôse An II La citoyenne Vacher de la Pouge prétend faire dessécher l’étang La citoyenne Vacher de la Pouge expose au citoyen Agent national du district de Montmorillon qu’elle possède deux prés touchant à un étang du citoyen Chambert, dans la commune de Plaisance, qui sont continuellement endommagés par le débordement dudit étang, ce qui fait que l’exploitante éprouve une perte considérable. En outre, ledit étang est sur le grand chemin de Moulismes à Plaisance et cause de grands dégâts sur ce même chemin attendu qu’il est cerné par l’étang et par un précipice. L’étang dont il est question n’est point dans la conception de la loi. Il n’est d’aucune utilité et ne sert point à abreuver les bestiaux parce qu’il est contigu à un réservoir intarissable. Ce considéré, citoyen, il te plaira de faire dessécher ledit étang en conformité de la loi et fera justice. Signé : Femme Vacher Renvoyé à l’Agent national de la commune de Plaisance pour, en exécution de la loi sur le dessèchement des étangs, du II frimaire dernier, provoquer la confiscation et dessèchement de l’étang dont il s’agit ou faire constater le motif de la conservation dans le plus bref délai. A Plaisance, faisant ma tournée, le 23 ventôse an II, l’Agent national pour le district de Montmorillon. Signé : Boissaux Citoyens, en réponse aux dires ci-dessus, la citoyenne femme Vacher nous dit donc fort hardiment qu’elle a deux près qui joignent à l’étang ci-dessus dénommé, ce que nous soutenons comme une fausseté de la part de ladite exposante, puisqu’il est vrai que ce même étang est joint : primo, du haut et d’un côté par un prè appartenant au citoyen Normand et, de l’autre part, au pâturage de la citoyenne veuve Bost de la Mondie; secondement, par le bas, il est joint par deux près appartenant au citoyen Donnet dont un de ces près, bon à faucher vers le sept à huit août, et dont le foin deviendrait propre à rien s’il n’avait pas l’eau sortant de l’étang ci-dessus dénommé. Citoyens, il est vrai que nous reconnaissons, au dessous des deux près de Donnet et le long du courant de l’eau, deux mauvais morceaux de pré en marécages et brandes, appartenant à la citoyenne Vacher, mais nous certifions qu’elle n’éprouve nulle part aucun dégât par le débordement de l’étang mais plutôt pour la mauvaise intelligence qu’elle a de faire un procès pour donner cours à l’eau. Elle aura bientôt desséché son mauvais terrain puisque ce même cours d’eau qui s’évacue de l’étang n’est produit que par des sources inaltérables (?). Il n’y avait donc que le citoyen Normand et la citoyenne Lamondie qui pouvaient demander le dessèchement de ce même étang. Bien loin de là, puisqu’ils en demandent de tout leur pouvoir, la conservation. D’ailleurs, citoyens, en conformité de la loir qui porte sur le dessèchement des étangs, nous avons envoyé un arrêté du Conseil général de notre commune par lequel nous vous exposions les faits urgents et nécessaires de laisser subsister celui du citoyen Chambert, dont vous voilà une seconde exposition : 1° – est qu’il sert d’abreuvoir à la plupart des bestiaux de la ville. 2° – est que nous n’avons pas d’autre endroit pour laver la lessive et pour faire aiguer les chanvres. 3° – qu’il arrose les prés ci-dessus dénommés. 4° – que si l’on coupe la chaussée l’on rendra la grande route de notre commune à Moulismes impraticable, vu que plusieurs autres citoyens ont des propriétés au-delà et qu’ils ne peuvent passer ailleurs que sur cette chaussée. Ainsi, citoyens, nous vous prions de laisser subsister l’étang; vous ferez justice et le bien général puisqu’il est vrai que le terrain qu’il occupe est d’une mauvaise qualité et n’est propre à rien. 19 mars 1794 29 ventôse An II Plantation de l’arbre de la Liberté Troisième décade de ventôse. En vertu de la loi qui ordonne la transplantation d’un arbre dénommé Arbre de la Liberté avant le premier germinal, ce que nous avons fait ce jourd’hui 29 ventôse l’an II de la République française. Il n’est donné aucune indication sur la nature de l’arbre ni sur le lieu de la plantation. 13 avril 1794 24 germinal An II Le pâturage du cimetière est affermé Nous, officiers municipaux, nous sommes assemblés à l’effet d’affermer le pâturage de notre cimetière qui a été mis et enchéri par plusieurs et par le plus offrant. Le dernier enchérisseur a été le citoyen Philippe Vauzelle qui l’a porté à la somme de 15 livres. Et s’est offert de payer en outre, et par dessus les 15 livres, pour la serrure et clous et pivot de la porte, une somme de 40 sols et une journée pour le travail, dont le tout se monte à la somme de 18 livres que ladite herbe lui coûtera pour ladite année. 1794 Statistique concernant la population masculine de Plaisance Au registre municipal, sous le titre Extrait des registres de la ville et commune de Plaisance, sans aucune autre indication, est dressée une liste de 98 hommes de 20 à 77 ans. Il est possible que cette liste ne soit pas tout à fait complète. Elle est néanmoins inintéressante et permet d’établir une répartition par âge. Hommes de 20 à 29 ans : 25 Hommes de 30 à 39 ans : 26 Hommes de 40 à 49 ans : 26 Hommes de 50 à 59 ans : 2 Hommes de 60 à 69 ans : 15 Hommes de 70 à 77 ans : 4 On peut constater que les vieillards étaient peu nombreux : on mourait relativement jeune. On ne compte, dans cette liste, que 7 hommes de plus de 62 ans. On peut se demander pourquoi les hommes de 50 à 59 ans étaient quasi inexistants. Les 15 volontaires mobilisés, dont 4 en Vendée et 4