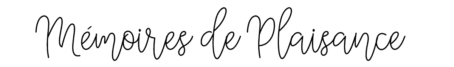À ASSEMBLÉE NATIONALE
Abolition des droits féodaux
Devant cette levée des masses paysannes, grande fut l’émotion à l’Assemblée Nationale. À partir du 4 août 1789, la question des droits féodaux fut à l’ordre du jour. Les discussions et les discours furent passionnés. Les Nobles firent ce qu’ils purent pour préserver leurs droits et ils y réussirent en grande partie. Dans la nuit, à deux heures du matin, ils renoncèrent, en principe, à leurs privilèges et le Clergé à la dîme, mais ce ne fut pas sans conditions, et la majorité du Tiers-États accepta ces conditions.
Ce n’est que dans la séance du 6 août que fut rédigé le décret de l’Assemblée qui commençait ainsi :
L’Assemblée Nationale abolit entièrement le régime féodal… Mais la suite du décret disait que, si certains de ces droits étaient abolis sans indemnité, la plupart étaient déclarés rachetables. Le prix et le mode de rachat seraient fixés plus tard. En attendant, les droits qui ne sont point supprimés par ce décret, continueront néanmoins à être perçus jusqu’au remboursement. Or ce remboursement, ce rachat, représentait des sommes considérables que les paysans étaient incapables de payer. Ils restaient donc toujours soumis à la plupart des droits féodaux.
C’est pourtant la première phrase du décret, la plus simple, que les paysans retinrent : L’Assemblée Nationale abolit entièrement le régime féodal.
Ils estimèrent qu’ils ne devaient plus rien aux seigneurs et ceux-ci eurent dorénavant les plsu grandes difficultés, malgré le décret de l’Assemblée qui leur donnait raison, à recouvrer leurs redevances.
11 août 1789
Mais la discussion n’était pas terminée à l’Assemblée, et ce n’est que le 11 août que la dîme, mais seulement la dîme, fut supprimée sans rachat. La fameuse nuit du 4 août s’était prolongée pendant sept jours. La plupart des droits féodaux subsitaient et ce n’est que grâce aux nombreuses luttes des paysans qu’ils furent enfin définitivement abolis, sans indemnité, par la convention du 17 juillet 1793, quatre ans après la nuit du 4 août.
Ainsi, c’est uniquement par leurs luttes personnelles, dures, longues, opiniâtres, que les paysans réussirent à contraindre leurs représentants à abolir véritablement le régime féodal, et il nous faudra aussi des luttes opiniâtres, comme celles que menèrent nos ancêtres, pour mettre à bas notre féodalité moderne : le grand Capital.
À NOTRE-DAME DE PLAISANCE-SUR-GARTEMPE
6 septembre 1789
Serment de la Garde nationale
Le 6 septembre 1789, le sindic et les officiers municipaux rassemblent les officiers et les soldats de la milice pour la prestation du serment de fidélité à la Nation, au Roi, chef de la Nation et à la Loi.
Ce serment se retrouve constamment dans les registres. Il est prêté par tous les responsables élus, par les assemblées municipales à l’occasion des réunions.
20 octobre 1789
Lois et arrêtés
À partir du 20 octobre 1789 sont inscrits à la main, sur le registre communal, les lois et règlements émanant de l’Assemblée Nationale. Ce sont des documents remarquables qui marquent réellement le changement d’ordre social : déclaration des droits de l’homme, égalité devant l’impôt, abolition de certains privilèges, établissement des pouvoirs régionaux et municipaux…
22 novembre 1789
Nomination d’un officier municipal
Aujourd’hui, 22 novembre 1789, les paroissiens, assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, sommes entrés en la maison de Fleurant Audoux, sindic de ladite municipalité, pour procéder à l’élection d’un membre en la place de Sieur Bost, perclus et allant demeurer à Montmorillon.
Envoi de cette démission est faite à M.M. les députés du bureau intermédiaire de Poitiers.
22 novembre 1789
Impositions
Le même jour, trois adjoints sont élus pour travailler à la confection des rôles (des impôts) pour 1790. Ce sont :
- Jean Roi, Marchand
- Joseph Duquerroux, Maçon
- Jacques Hebras, Laboureur
6 décembre 1789
La contribution patriotique
L’été 1788 s’était montré très humide. Des orages de grêle avaient détruit une bonne part des récoltes dans la moitié nord de la France. Un froid rigoureux avait sévi durant l’hiver 1788-1789. Aussi, depuis le printemps 1789, les vivres manquaient, le peuple avait faim et les prix avaient considérablement augmenté. Des secours étaient nécessaires.
En septembre 1789 paraît un décret instituant la contribution patriotique. Les dons affluent à l’Assemblée. Des femmes de peintres, Mme Fragonard, David, Vernet et Gérard offrent leurs bijoux. Une petite fille vient offrir les meubles en or de sa poupée. Toutefois, les dons patriotiques ne rapportent qu’une douzaine de millions. Necker, ministre du Roi, fit voter par l’Assemblée plusieurs emprunts qui ne furent pas couverts. L’Assemblée, malgré ses hésitations, vota une contribution forcée du quart de tous les revenus supérieurs à 400 livres.
Le 6 décembre 1789 à Plaisance, le syndic convoque une Assemblée pour le versement de cette contribution patriotique. Il ne s’est présenté personne pour faire leur déclaration.
À la deuxième convocation, le 13 décembre, personne non plus ne s’est présenté. Il est peu probable qu’il existât à Plaisance des particuliers dont le revenu atteignait 400 livres. Pour un ouvrier, la journée de travail se montait à 12 sols environ, ce qui lui donnait un revenu de 180 livres pour 300 jours de travail. Les artisans et les commerçants pouvaient peut-être atteindre les 400 livres. C’est sans doute pour cette raison que personne ne se présenta.
Le 11 avril 1790, Bonneau, vicaire et maire, donnera connaissance d’une lettre envoyée par Delion de Surade, prieur-curé de Plaisance et Député aux États-Généraux.
Paris le 24 mars 1790, je soussigné, prieur de Notre-Dame de Plaisance, Député du Poitou aux États-Généraux constitués en Assemblée Nationale, et membre du Comité des Finances, déclare avec vérité que la somme de 900 livres, excédant le quart de mon revenu, quitte de toutes charges, laquelle somme néanmoins j’offre à la nation pour ma contribution et don patriotique, et attendu mon séjour à Paris, je m’oblige de délivrer et remettre au trésor de la nation la susdite somme, le tout suivant le décret de l’Assemblée.
Signé : Delion de Surade
16 décembre 1789
L’égalité devant l’impôt
La question de l’égalité devant l’impôt avait été posée à l’Assemblée Nationale au cours de la nuit du 4 août. Le Vicomte de Noailles et le Duc d’Aiguillon, deux grands féodaux, avaient proposé que l’impôt soit payé par tous les individus du royaume, dans la proportion de leurs revenus. À leur appel, l’ensemble des Nobles et du Clergé avait renoncé aux privilèges concernant l’impôt.
La Déclaration des Droits de l’Homme, votée le 27 août 1789, précisait dans son article 13 : Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.
Le 16 Decembre 1789 une assemblée est donc réunie à Plaisance, pour la confection du rôle des ci-devants privilégiés. Il a été délibéré qu’il serait suspendu jusqu’à huitaine pour voir s’il n’y aurait pas d’autres ordres.
Le 27 décembre 1789 l’Assemblée décide qu’il serait sursis à la confection du rôle des six derniers mois pour les ci-devants privilégiés.
Vous remarquerez que les notables de Plaisance ne semblaient pas montrer beaucoup de zèle à faire payer les riches. Les ordres reçus manquaient-ils de précision ? Curieuse attitude de prudence cependant ! Avant d’éxecuter l’ordre, attendre le contre-ordre !
1. – Commentaires de Louis Germaneau
1789
À Plaisance
Sources : La vie municipale de Plaisance sous la révolution de 1789, Louis Germaneau. Ed. Service écologie et biogéographie de la faculté des sciences fondamentales et appliquées de l’université de Poitiers – 1981