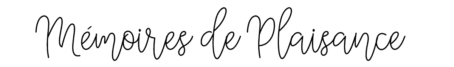Constitution civile du Clergé
Démission des responsables municipaux.
Une série de démissions va désorganiser l’administration de la commune.
30 août 1790
Le 30 août 1790, démission de Delion de Surade (enregistrée le 10 octobre 1790).
Le Sieur Delion de Surade, Prieur-curé de la paroisse de Notre-Dame de Plaisance :
Nous a fait représenter par le Sieur Silvain Bonneau, vicaire de cette paroisse, la démission qu’il a faite à Paris, le 30 août de la présente année et par devant les Conseillers du Roi, notaires à Paris, de son dit prieuré-cure de Plaisance, et de suite nous avons adressé la dite démission à Messieurs du Directoire du district de Montmorillon.
12 septembre 1790
Le 12 septembre 1790, Silvain Bonneau, maire depuis le 28 février 1790, écrit lui-même au registre sa démission de maire, en présence de la commune et municipalité.
Le même jour, Vachier de la Pouge, secrétaire-greffier depuis le 24 mai 1789, donne sa démission en présence des officiers municipaux réunis à l’église.
19 septembre 1790
Le 19 septembre 1790, Germain Normand, premier membre du Conseil des Notables depuis le 25 février 1790, inscrit lui-même sa démission au registre.
Aucun évènement, dans la paroisse, ne semble avoir provoqué cette série de démissions, et il faut aller probablement en chercher les raisons dans l’opposition violente du Clergé, surtout du Haut-Clergé, aux décrets de l’Assemblée Nationale.
Les biens du Clergé
D’avril 1789 à juin 1790, durant près de 15 mois, des troubles graves agitèrent le pays. Le 11 août 1789 la Dîme avait été supprimée. Cependant, dans de nombreuses régions, en particulier dans le midi, le Clergé continuait à la réclamer aux paysans.
3 novembre 1789
Le 10 octobre 1789, commence à l’Assemblée, la discussion sur les biens du Clergé. Elle considère que le Clergé n’était pas véritablement propriétaire de ses biens, que le droit ecclésiastique lui interdisait de les posséder, qu’il n’était même pas usufruitier, que ces biens avaient été injustement acquis grâce aux aumônes qu’ils auraient dû redistribuer aux malheureux et qu’ils s’étaient appropriés. Aussi, le 3 novembre 1789, l’Assemblée décrète que les biens du Clergé appartiendraient à la nation.
Elle n’avait pas dépouillé le Clergé de ses moyens de vivre. Elle avait voté 60 000 000 pour les curés. Chaque curé percevait une pension de 1200 livres par an. C’était beaucoup plus, parfois le double, que ne percevait un curé de campagne auparavant. Le cahier de doléances de Plaisance pensait que 500 livres pouvaient suffire. 33 000 000 étaient prévus pour les ecclésiastiques isolés et 3 000 000 pour les évêques qui, eux seraient loin de leur revenu traditionnel pouvant atteindre des sommes de l’ordre de 1 000 000 de livres par an. Les curés, en grande partie, furent satisfaits.
février 1790
En février 1790, il fut décidé que les couvents, les cloitres, seraient ouverts, c’est-à-dire que les moines ou les religieuses qui y étaient entrés à contrecœur auraient le droit de reprendre leur liberté. S’ils restaient ecclésiastiques, ils percevraient la pension prévue par la loi.
Il n’y aurait plus alors qu’un établissement pour chaque ordre (franciscains, dominicains, bénédictins, etc…) par département où se rassembleraient ceux qui désireraient continuer à vivre en communauté (ils seraient également pensionnés).
Des inventaires devaient être faits dans les couvents revenant à la nation, ainsi que l’estimation de tous les biens dépendant du Clergé.
3 mai 1790
Estimation des biens du Clergé
Le 3 mai 1790, les biens du Clergé étaient donc devenus biens nationaux.
Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge du pouvoir, d’une manière convenable, aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d’après les instructions des provinces.
Cette immense étendue de terres, qui représentait un quart du territoire français, était destinée à être vendue, mais cela ne pouvait se faire qu’en de longues années. L’État avait besoin d’argent, aussi fut-il décidé que la valeur de ces biens servirait de garantie aux nouveaux billets : les Assignats. On pourrait donc échanger le nouveau papier monnaie contre la terre. Il fallait, par conséquent, savoir quelle valeur totale représentait ces biens.
Le biens du Prieuré de Plaisance firent l’objet d’une estimation le 19 octobre 1790.
19 octobre 1790
Nous, maire et officiers municipaux de la ville et commune de Notre-Dame de Plaisance, assemblés en la chambre municipale, avons délibéré sur le choix que nous avions à faire pour faire l’estimation des biens dépendant du Prieuré de cette ville. Le choix ayant tombé sur le Sieur Denis Augris et Charles Chamber, tous deux habitants de la ville de Montmorillon, savoir, le Sieur Chamber paroisse de Consize et le Sieur Augris paroisse St Martialle, lesquels nous nommons et commettons pour faire l’estimation des fonds dépendant du dit Prieuré de la dite ville et paroisse de Notre-Dame de Plaisance suivant le jour qu’il plaira à Messieurs du Directoire du disctrict de Montmorillon.
Le drame du curé Bonneau
C’est le 28 février 1790 que le curé Bonneau fut élu maire de Plaisance. Comme la majorité des curés, il avait accepté de servir la cause du peuple. La révolution avait, non seulement, augmenté ses revenus, mais aussi l’avait placé à la tête de sa commune, représentant spirituel en tant que curé, représentant civil en tant que maire.
Mais, en mai 1790, le Clergé et les catholiques fanatiques provoquèrent des soulèvements dans le Midi, à Orange, à Avignon, à Arles… à Toulouse, à Nimes et à Montauban des catholiques forment des milices. Ils propagent des brochures mensongères. On fait des neuvaines, des processions, des pénitences, des cérémonies expiatoires. Des Gardes Nationaux, des protestants seront massacrés en juin 1790.
Les évêques désignèrent les prêtes, amis de la Révolution, à la haine populaire. Ils déclarèrent que ces prêtres étaient contre l’église, hors de la communion, des évêques et du St-Siège, qu’ils étaient des membres pourris, rejetés, renégats et apostats.
Imaginons le désarroi, le drame de conscience du malheureux curé Silvain Bonneau, rejeté, insulté, excommunié par ceux auxquels sa foi lui commandait obéissance ! En tant que maire, il devra être contraint de procéder à l’inventaire des biens possédés par le Clergé de Plaisance et dont il est lui-même gérant.
Il adopte la solution la plus sage, celle qui lui permet de ne renier ni sa conviction politique, ni sa foi : il donne sa démission de ses fonctions de maire.
1789
à Plaisance
Sources : La vie municipale de Plaisance sous la révolution de 1789, Louis Germaneau. Ed. Service écologie et biogéographie de la faculté des sciences fondamentales et appliquées de l’université de Poitiers – 1981. Gallica BNF