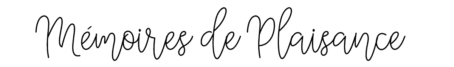Du XVIIIe siècle, de 1700 à 1800, sont conservés des archives principalement autour de la vie religieuse locale, de la paysannerie et de la Révolution française qui apporta de grands changements. On trouve encore :
- Les recensements, les premières dispositions régissant la localité, la vie agricole, …
- Les pratiques économiques, les métiers, …
- Les premiers pas de la vie municipale.
Grand hiver 1709
Le froid, commença le 6 janvier 1709, et dura jusqu’au 24 dans toute sa
rigueur. Les semences furent anéanties. Le désastre fut si grand que les oeufs
de poule valaient aux environs de 25 et 30 sous la douzaine car les pondeuses
pour la plupart étaient mortes de froid, ainsi que les bestiaux dans les étables.
On voyait tomber, gelée la crête des volailles, quand celles-ci avaient survécu
au froid. Un grand nombre d’oiseaux, canards, perdrix, bécasses et merles moururent, qu’on trouvait dans les chemins, et sur les épaisses glaces et fréquentes neiges.
Sources : Histoire du climat depuis l’an 1000 Antoine Ladurie
https://editions.flammarion.com/histoire-du-climat-depuis-lan-mil/9782081451988
En 1709, toujours à Limoges, bon nombre d’habitants furent contraints de loger dans les caves et de cohabiter avec les rats. En 1765-66, les consuls de Limoges obtinrent de l’évêque qu’il permette les aliments gras quatre fois par semaine durant le carême, seul moyen pour les habitants de renforcer leurs défenses immunitaires éprouvées par un froid extrême.
En 1788-89, le froid fut tellement rude qu’il était devenu impossible de creuser la terre pour enterrer les morts. Les bières furent remises dans le sépulcre de Saint-Pierre-du-Queyroix et dans le caveau situé sous la nef. D’autres hivers remarquables ont été recensés en 1870-71, 1879-1880, 1892-93, 1914, 1929… et 1956, où l’on battit tous les records. En général, la Vienne formait une couche de glace de plusieurs centimètres d’épaisseur pouvant supporter, dit-on, le poids d’un tombereau attelé.
Sources : Le populaire du centre 19 février 2016
Bureau des acquis en 1737 à Plaisance
les revenus au XVIIIe Siècle
L’estimation des salaires est un sujet d’une grande complexité. En effet, les données restent trop souvent éparses et les informations disponibles concernent surtout le XVIIIe siècle. De plus, les modalités de paiement sont diverses et le taux des rémunérations est soumis à d’importantes variations géographiques ou saisonnières. Ces contraintes rendent difficiles les comparaisons rigoureuses entre les professions, les lieux et les époques. On observe une grande diversité des salaires et des gages, pour mémoire :
- 1 livre tournois = 20 sous (ou sols).
- 1 sou = 12 deniers.
Donc 1 livre tournois = 20 sous = 240 deniers.
Le prix du pain (1 livre = de 300 à plus de 600 g) :
1 pain de 4 livres : 8 sols en moyenne, mais 5 sols dans les années d’abondance céréalière et au moins 12 sols dans les années de mauvaises récoltes.
1 kg de pain blanc : de 0,40 F à 0,43 F de 1855 à 1913
Selon Vauban, pour une famille de manœuvrier (quatre personnes dont deux enfants), la consommation annuelle de blé, moitié seigle, moitié froment pour fournir du pain est de 10 setiers, soit environ 800 grammes par jour et par tête.
Pour comprendre et estimer le montant des salaires de l’Ancien Régime, il faut tenir compte de plusieurs critères :
- Le salaire des femmes et des adolescents est généralement inférieur de moitié à celui des hommes, et le salaire des enfants est inférieur de moitié à celui des femmes.
- À l’intérieur d’un même métier, les différences de salaires sont liées au degré de qualification.
- Les rémunérations des travaux agricoles de la pleine saison (de mars à septembre/octobre) sont supérieures de près du double à celles de la saison morte (de septembre/octobre à janvier).
- Les salaires sont plus élevés dans les villes et à proximité des centres urbains que dans les zones les plus reculées sans voies de communication.
- Selon les situations, le salaire était réglé à la pièce (tant pour un produit fini), à la tâche (tant pour la main-d’œuvre), à la journée de travail (de 10 à 13 h), à la semaine, au mois ou à l’année. Les salaires à la pièce, à la tâche et à la journée étaient rarement versés en argent liquide. Le plus souvent, le règlement était mixte : une partie en argent et le reste en denrées, en échange de biens ou en services.
- Enfin, dans certains cas, le salarié était logé, nourri et blanchi et il avait parfois droit à des avantages en nature (une paire de sabots offerte, par exemple).
Exemples de salaires à la tâche ou à la journée
- Semailles et frais de labours pour un champ de montagne : 46 livres et 8 sols en 1774.1
- Labourage et frais de moisson pour un champ de montagne : 18 livres en 1775.1
- Dépense de fumier dans les vignes : 58 livres 16 sols en 1776.1
- Raccommodage des vitres d’une maison, puis faire à neuf celle du cabinet : 4 livres en 1741.2
- six journées à « aider à faucher au foin » : 2 livres 10 sous en 1741.2
- quatre journées à « aider à battre » (battage des céréales) : 2 livres en 1741.2
- sept journées à aider à refaire le mur du champ en 1741 : 7 livres 3 sous.2
- cinq journées de charron pour un chariot neuf : 7 livres en 1742.2
- une journée de menuiserie pour confectionner un buffet : 10 sous en 1743.2
- une journée pour coudre du cuir : 10 sous en 1745.2
- une journée de 10 heures de travail à entrer la luzerne : 20 sous en 1800 d’après le Journal de D. Boutrouë.
- quatre journées à scier et percer deux grandes échelles : 2 livres 8 sols en 1718.3
- cinq journées à rompre du bois en 1723 : 3 livres.3
- deux journées de travail pour abattre une loge en ruine : 34 sols en 1724.3
- une journée de maçonnerie pour enduire de chaux une cour : 15 sols en 1730.3
- Pour le charroi d’une charretée de foin : 15 livres en 1748.3
- une journée de couvreur à réparer une toiture : 15 sols en 1749.
- 1 – d’après M. Dorigny
- 2 – d’après M. Vernus
- 3 – d’après Duchemin du Tertre
La vie municipale sous la révolution française De 1789

M. Louis Germaneau nous a laissé une étude très détaillée sur la vie municipale de Plaisance sous la révolution de 1789. Ses recherches ont été publiées après son décès par le Service Écologie & Biogéographie, Faculté des sciences fondamentales et appliquées de l’université de Poitiers.
Voici l’avant propos de l’ouvrage publié en 1981
Louis n’est plus
Malgré le mal qui l’envahissait et le tenaillait douloureusement, il avait tenu à rédiger le résultat de ces dernières recherches.
C’est ainsi que ses synthèses sur l’écologie du développement des bromes voient le jour dans notre publication « écologie et biogéographie » en avril 1979 et cette année dans le bulletin de la société botanique de France.
Restent deux manuscrits concernant son terroir auquel il était profondément attaché : Plaisance. Celui qui fait l’objet du présent numéro d’écologie et biogéographie et l’autre, de linguistique locale, qui verra le jour dès que les moyens financiers de notre service le permettront. Malou, sa compagne dévouée, a assumé avec abnégation la tâche ingrate du recollement, du collationnement et de la frappe des manuscrits. Je ne dirais pas le mérite, ni la modestie de celui dont les cartes de visite portaient la seule mention : ancien élève des écoles publiques de la Vienne.
C’était mon ami.
Cl.Ch.Mathon
Directeur du service
Poitiers le 4 septembre 1981
Découvrir les recherches de Louis Germaneau autour des premiers pas de la commune…
Affaires diverses de mars à juillet 1790
Nomination d'un huissier
Jean Vauzelle est nommé huissier de la municipalité.
Sur le bon, le louable rapport que l'on nous a fait de la personne du nommé Jean Vauzelle, habitant de cette ville et paroisse de Plaisance, de sa vie et mœurs, capacité, d'un commun accord l'avons choisi pour occuper la place d'huissier de notre municipalité.
Ordonnances concernant la vente du vin et les étrangers
Le 3 avril 1790, le corps municipal prend deux ordonnances de police :
- Interdiction de servir et vendre du vin pendant le service divin.
- Interdiction de recevoir un étranger sans en donner connaissance au maire.
Deffense sont faittes à tous les marchands, aubergistes, cabarestiers, de n'avoir point à donner ny fournir de vin à aucuns habitants de la dite ville et paroisse de Plaisance pendant le service divin, sous les peines d'une somme de quatre livres d'amende et, en cas de récidive, de ce qui sera déterminé par nous maire et officiers de ladite municipalité, le tout hors les voyageurs que nous exceptons. En outre de n'avoir point à recevoir aucun étranger chez eux de quelques qualités et conditions qu'ils soits sans donner avis et connaissance, sur le champ, à nous maire ou premier d'icelle ditte municipalité.
Contribution patriotique de Delion de Surade
Le 11 avril 1790, Bonneau, Vicaire et maire, donne connaissance d'une lettre envoyée par Delion de Surade, Prieur--Curé de Plaisance et député aux États-Généraux.
Paris le 24 mars 1790, je soussigné, prieur de Notre-Dame de Plaisance, député du Poitou aux États-Généraux constitués en Assemblée Nationale et membre du Comité des Finances, déclare avec vérité que la somme de 900 livres, excédant le quart de mon revenu, quitte de toutes charges, laquelle somme néanmoins j'offre à la nation pour ma contribution et don patriotique, et attendu mon séjour à Paris, je m'oblige de délivrer et remettre au trésor de la nation susdite somme, le tout suivant le décret de l'Assemblée Nationale.
Signé : Delion de Surade
Audoux vend du vin pendant la messe
Il faudra trois séances pour juger l'affaire Fleurant Audoux qui, malgré l'ordonnance du 3 avril, a vendu du vin pendant l'office divin, le jour de la Qasimodo.
Deux fois l'affaire sera remise à la prochaine séance. Enfin, la municipalité, réunie au château Ringuet, que nous avons choisi pour notre auditoire, à défaut de maison commune, accepte l'offre, faite par Audoux, de payer quatre livres d'amende, sur lesquels seront prélevés, par faveur, les frais d'huissier (Une livre). Les trois livres restantes ont été distribuées, sur le champ, à cinq des plus nécessiteux de la paroisse :
- 12 sols à François Thabuteau
- 12 sols à Jean Vauzelle
- 12 sols au Sieur Beauséjour
- 12 sols à Doucelin
- 12 sols à la veuve Mesmin
Liste des 31 soldats de la ville en 1790
- Jean Bardeau
- Jean Roy fils
- Jean Tabutteau
- Gaspard Audoux
- Jean Ribardière
- Jean Poitevin
- Pierre Lefort
- Jean Vauzelle
- Martial Durepaire
- François Thabutteau
- Félix Moreau
- François Chartier
- Joseph Vauzelle
- Silvain Demazeaux
- Jean Ébras
- Silvain Petreau
- Jean Dupras
- Mathurin Brunot
- Jean Deschamp
- Jean Lachaume
- Charles Plat
- Marc Brussat
- Pierre Vergnieaud
- Pierre Gourdonneau
- Jacques Brussat
- Pierre Mesmain
- Marc Desmaisons
- Marc Baronnet
- Jean Roi Maçon
- Jean Lefort
- François Audoux
Liste des 18 soldats de la campagne en 1790
- François Chartier, de la Merlatrie
- Silvain Augais
- Pierre Augais
- Morice Mercier
- Felix Lelot
- Jacques Dupré
- Pierre Nivet
- Jean Pain
- Fleurant Augris
- Jean Jalladeaux
- Barthelemy Valat
- Jean Sironneau
- marc Ebras
- Anthonin Perrin
- René Barbier
- Gervais Thabutteau
- Mathurin Brunet
- Jean Augris
NOTES SUR LES POIDS ET MESURES AU XVIIIe siecle & Lexique
Mesures de capacité :
- Le Boisseau, variable suivant les lieux, valait 13 litres.
- Le Litron, un seizième de boisseau, valait 0,8 litre.
- Le Quarteron ou Cartron, valait probablement 1/4 de litron, soit 0,2 litre environ.
Mesures de Poids :
- La Livre, dite de Paris valait 490 gr.
- Le Cartron valait un quart de livre soit un peu plus de 122 gr.
- La pile ou pille, était une série de poids en cuivre, en forme de godets, qui s’emboitaient les uns dans les autres.

Petit lexique
- Terres censives
- Droit de blairée
- Droit de triage
- Droit de libre pâture