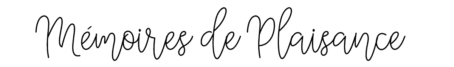Le XIIIe siècle
Plaisance est citée dans le dictionnaire topographique de M.L. Redet, d’après Fonteneau, et datée de 1302. Cependant elle apparaît déjà dans d’autres écrits (Maison-Dieu, Hommages d’Alphonse, Pouillé de Gautier…) sans être datée avec certitude.
- Plaisance est mentionné dans les textes comme Plesencia, Plessencia ou Pleissencia depuis 1258 (Hommages p. 83, 84, 112)
- Plaisance est mentionné dans les textes comme Plaisance, 1302 (Fonteneau, t. XXIV, p. 474)
- Plaisance est mentionné dans les textes comme Placencia, 1358 (Pouillé de Gautier, f° 175 v°)
Le village au XIIIe siècle
Deux principaux écrits relatent la situation du village à cette époque, ceux de Robert du Dorat et ceux issues de l’inventaire toponymique de M.L. Redet.
- D’après Redet, Plaisance est le nom de l’endroit du siège de la communauté religieuse de Lesterps depuis le XIIIe siècle.
- D’après Robert du Dorat au XVIe siècle, Plaisance sur Gartempe était entourée de murs, fossés et de tours. De hautes murailles fermaient la cité et il subsistait quelques portes et fenêtres du XVe et XVIe siècle.
Les sites fossoyés (L’Âge-de-Plaisance), où la construction en bois est majoritaire, sont la manifestation la plus caractéristique de la résidence de la petite aristocratie. La pierre commence cependant à être utilisée par les plus fortunés.
Fossé(s) : tranchée placée à l’endroit le plus fragile ou entourant une fortification pour permettre un isolement. Creusé dans la terre ou taillé dans la roche, le fossé est sec.
Sources : laissez-vous conter les chateaux au Moyen Âge – Philippe Durand Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais
Les rois de France Louis VII (1137-1180), Louis VIII (1223-1226), Philippe le bel (1285-1314) en 1308, puis Charles IV, Charles V (1338-1380) en 1375 et Louis XI se sont rendus à plusieurs reprises au chevet de Notre-Dame de Plaisance.
Au XIIIe siècle, l’église qui était en ruine fut rebâtie et agrandie, entourée de murs flanqués de tours et de fossés à la demande de Louis VIII. Il accorda au prieuré des titres et des prérogatives ainsi que de revenus importants comparables aux autres villes. Ces titres perdurèrent jusqu’au XVIIIe siècle.
« Dans les dernières années du XIIIe siècle ou dans les premières années du XIVe siècle, la Maison-Dieu de Montmorillon fut confiée aux Ermites de Saint-Augustin. Les pieux moines furent, à peu près à la même époque, préposés au service du fameux sanctuaire de N.-D. de Plaisance, situé à quelques lieues de Montmorillon, dans un site ravissant, qui lui valut son nom.»
Malheureusement, les envahissements des Anglais les en chassèrent bientôt, et ruinèrent l’église qu’avaient enrichie les dons généreux des princes et des particuliers. De ce sanctuaire autrefois si célèbre, visité par Charlemagne, Louis VIII et la plupart des rois de France, du prieuré et de la maladrerie de Plaisance, la Révolution a fait une pauvre église réduite à un tiers de ses mesures primitives et une paroisse sans prestige, qui compte à peine 500 habitants.
Après cet épisode malheureux, Philippe le Bel rétablit l’ordre des moines Augustins et leur fit don de plusieurs moulins situés sur la Gartempe. De plus, il ordonna que les dîmes de la paroisse de Persac leur soit délivrés à la condition qu’ils assurent l’entretien d’une lampe ardente, jour et nuit, et qu’ils distribuent aux pauvres 544 boisseaux de blé (moitié en froment et moitié en seigle) les jours de carême.
Sources : La maison Dieu et le petit séminaire de Montmorillon par l’abbé E. Menard-1894.
En 1358, la peste bubonique décime la moitié de la population du Poitou. Les cimetières sont pleins et les moines creusent des fosses communes. On recouvre les murs de chaux et l’on brule les maison infectées.
Que savons-nous du village à cette époque ?
- Il était entouré de murs, tours et fossés depuis la protection de Louis VIII.
- Il ne reste plus qu’un tiers de l’Église Notre-Dame après les destructions successives.
- Elle contenait un transcept et un coeur qui acceuillaient 9 chapelles de hauts dignitaires de la région.
- Le village s’animait principalement autour de deux rues.
- Les axes de circulation comme la route de Saulgé-Montmorillon actuelle ou bien la route menant à Moulismes n’existaient pas.
- La ville accueillait un Gouverneur et une garnison.
Les religieux de Lesterps s'installent à Plaisance
D’après Robert du Dorat, la cité de Plaisance était fort jolie, étant environnée de fossés et de tours, mais elle a souffert, tant de ruines et de désolations, par l’injure des gueux, tant des Anglais que de la Ligue*, qu’elle n’est rien à présent à côté de ce qu’elle a été…
La Maison-Dieu de Montmorillon
Les Ermites de Saint-Augustin
Au cours du 11e siècle, trois hommes de Montmorillon, dont un prêtre, Robert, Acfred et Umbert, souhaitent établir une église en l’honneur de sainte Marie-Madeleine. Rencontrant l’opposition des prêtres du château, ils fondent un premier établissement hospitalier pour les pauvres. Autrefois situé entre le chauffoir et l’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent, l’hôpital, disparu depuis le début du 19e siècle, est le lieu d’accueil des malades sous la garde de religieux.
Vers 1102, cette première fondation trouve un second souffle lorsque « Robert du Puy », longtemps désigné par différents auteurs comme Seigneur de Vacheresse (Persac), revenant de pèlerinage à Jérusalem, consacre sa fortune pour faire relever de ses ruines cette fondation. Soutenue par les seigneurs locaux et les grands de l’époque, la Maison-Dieu devient prospère. Pierre II, évêque de Poitiers, fonde à cette intention une confrérie de clercs en 1107. Guillaume le Troubadour, comte du Poitou et 9e duc d’Aquitaine la prend sous sa protection. À une date inconnue, l’établissement adopte la règle de saint Augustin et, peut-être vers 1300, passe entre les mains des ermites de Saint-Augustin.
Sources : https://www.montmorillon.fr/maison-dieu/
1369
Le Poitou passe sous le joug des anglais
Sir John Chandos est nommé Sénéchal par le roi d’Angleterre et s’installe à Poitiers. Deux ans plus tard, en 1371, Duguesclin, à la tête d’une armée de 3000 hommes, prend d’assaut la ville de Montmorillon. La garnison anglaise n’en survivra pas. Sir John Chandos mourut le 31 décembre 1369, après un coup de lance reçu lors d’âpres combats engagés à Lussac-Les-Châteaux. Il fut transporté au château de Mortemer (Valdivienne), forteresse anglaise la plus proche à l’époque. C’est la première phase de la guerre de cent ans.
*La ligue protestante.